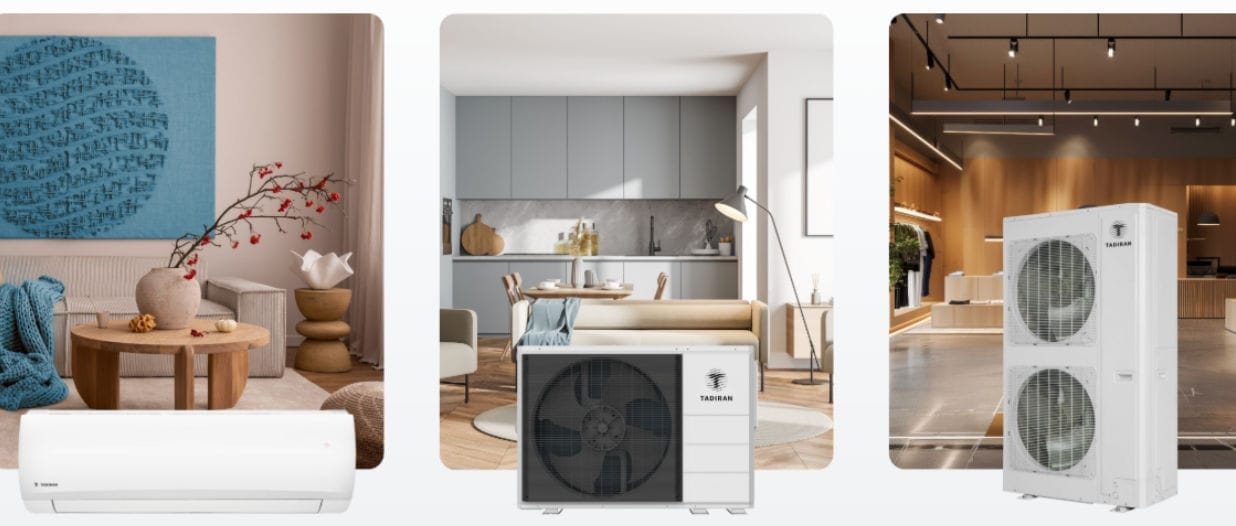Énergie et climat : la politique chinoise est bénéfique pour l'environnement et son économie

En matière de progrès énergétique et climatique , aucun pays au monde ne peut rivaliser avec la Chine. D'une part, la Chine est le plus grand émetteur mondial de CO2, d'autre part, elle est le plus grand producteur de technologies d'énergies renouvelables.
La République populaire de Chine, qui s'est longtemps attachée à renforcer son rôle de puissance énergétique verte , se concentre désormais non seulement sur le développement (et l'exportation) des énergies renouvelables, mais aussi sur la réalisation de ses objectifs climatiques. Le discours du président Xi Jinping devant l'Assemblée générale des Nations Unies l'a confirmé : il y a annoncé une nouvelle stratégie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la Chine. C'est la première fois qu'il parle de réduction des émissions plutôt que de leur confinement : un tournant historique.
Cette politique, diamétralement opposée à celle des États-Unis, est également économiquement avantageuse. En 2024, pour la première fois, les technologies propres ont contribué à plus de 10 % de la croissance économique chinoise , avec des ventes et des investissements d'une valeur d'environ 1 900 milliards de dollars (Source : analyse CREA pour Carbon Brief ). Mais cette dynamique sera-t-elle suffisante à long terme ?
Concernant la Chine et ses objectifs énergétiques et climatiques, il convient de commencer par le discours du président Xi Jinping lors du Sommet des Nations Unies sur le climat. Le Premier ministre a rappelé l'Accord de Paris, qu'il avait signé dix ans auparavant avec le président américain de l'époque, Barack Obama. Mais il est allé plus loin : il a annoncé les nouvelles contributions déterminées au niveau national ( CDN ) de la Chine.
D’ici 2035, le pays réduira ses émissions nettes de gaz à effet de serre de 7 % à 10 % par rapport aux niveaux de pointe. De plus, il portera la part des énergies non fossiles dans sa consommation énergétique totale à plus de 30 % et multipliera par plus de six sa capacité installée d’énergie éolienne et solaire par rapport à 2020, pour atteindre un total de 3,6 TW. À cela s’ajoute l’augmentation de la capacité forestière totale à plus de 24 milliards de mètres cubes et la promotion des véhicules à énergies nouvelles ( électriques, hybrides et à hydrogène ), qui devraient devenir la norme sur le marché des véhicules neufs.
Les politiques énergétiques et climatiques de la Chine sont principalement axées sur la capacité de production d'électricité installée cumulée. La capacité installée du pays a atteint 3,72 milliards de kW à la fin septembre 2025 , soit une augmentation annuelle de 17,5 %, selon les données officielles publiées en octobre par l'Administration nationale de l'énergie et relayées par l'agence Xinhua .
L’augmentation du photovoltaïque est particulièrement significative : la capacité de production enregistrée était de 1,13 milliard de kW, soit une augmentation de 45,7 % par rapport à la même période en 2024.
L'énergie éolienne connaît également une forte croissance (+21,3 % sur un an) : la capacité de production éolienne a atteint près de 582 millions de kW. En termes d'investissements, ceux alloués par les principales entreprises chinoises de production d'électricité ont atteint 84,4 milliards de dollars (+0,6 % par rapport à 2024). Sur la même période, environ 61,5 milliards de dollars ont été investis dans des projets de réseau électrique , soit une augmentation de 9,9 % sur un an.
Mais dès 2024, les données chinoises affichaient des résultats exceptionnels. Selon l' Institut des énergies renouvelables, s'appuyant sur les données de l'Administration nationale de l'énergie, la Chine avait installé 277 GW de capacité photovoltaïque et 80 GW de capacité éolienne, portant sa capacité solaire à 890 GW et sa capacité éolienne à 520 GW. Ces résultats permettent d'atteindre l'objectif de 1,2 TW de capacité d'énergies renouvelables fixé par le président Xi Jinping en 2020, un objectif initialement prévu pour 2030, que la Chine a finalement atteint avec cinq ans d'avance .

Dans le domaine du photovoltaïque , les projets en zones désertiques sont particulièrement remarquables. Un projet est en cours dans le désert de Kubuqi, au nord-ouest de la Chine, pour la construction d'un gigantesque parc solaire. Sa mise en service est prévue pour 2030. Long de 400 kilomètres et large de 5 kilomètres, il aura une capacité de production maximale de 100 GW. Ce désert , surnommé la « mer de la mort » en raison de ses conditions de vie extrêmes, s'inscrit dans le cadre du plan pluriannuel chinois de construction d'un « grand mur solaire » destiné à produire suffisamment d'énergie pour alimenter Pékin, comme le souligne la NASA .
Le projet Kubuqi illustre l'engagement plus large de la Chine en faveur de l'intégration des énergies renouvelables à la restauration écologique. Dans les vastes étendues arides du nord du pays, les technologies de pointe transforment la lutte contre la désertification. Selon les données du gouvernement chinois , 53 % des terres désertifiées et cultivables de Chine ont été restaurées, ce qui représente une réduction nette d'environ 4,33 millions d'hectares de terres dégradées.
Environ un quart du territoire chinois est classé comme « désertifié », et les campagnes de lutte contre l'avancée des sables remontent aux années 1970. Le gouvernement chinois a lancé le programme des « Trois Nords », qui a débuté en 1978 et se poursuivra jusqu'en 2050. Ce programme prévoit un rôle actif de la technologie photovoltaïque dans la lutte contre la désertification.
De même, la Chine mise sur le développement à grande échelle de l'énergie solaire flottante , avec notamment un projet offshore de 1 GW dans la province du Shandong et un projet de 400 MW mis en service en août. Récemment, le projet pilote de démonstration photovoltaïque offshore de 1,8 GW situé à Qinhuangdao, dans le comté de Changli, est entré dans sa phase de construction à grande échelle.
La politique énergétique et climatique ciblée de la Chine contraste fortement avec celle des États-Unis sous l'administration Trump. Comme le soulignait récemment le New York Times , tandis que les États-Unis misent sur les énergies fossiles et font pression sur les autres pays pour qu'ils y aient recours, la Chine investit dans les technologies solaires et éoliennes , ainsi que dans le stockage par batteries , avec l'ambition de devenir le premier fournisseur mondial d'énergies renouvelables et des produits qui en dépendent.
Le New York Times souligne lui-même que sur le plateau tibétain, à près de 3 000 mètres d'altitude, les panneaux solaires couvrent une superficie sept fois supérieure à celle de Manhattan. « Aucun autre pays au monde n'exploite les hautes altitudes pour produire de l'énergie photovoltaïque, éolienne et hydroélectrique à une telle échelle que la Chine sur le plateau tibétain. Grâce à des investissements et une planification gouvernementaux massifs, les compagnies d'électricité réduisent la dépendance du pays aux importations de pétrole, de gaz naturel et de charbon, une priorité nationale. » Les énergies renouvelables permettent à la Chine d'alimenter 48 000 kilomètres de lignes ferroviaires à grande vitesse et son parc automobile électrique en pleine expansion.
Tous ces efforts, axés sur l'amélioration de l'énergie et du climat, produisent-ils également des retombées économiques positives ? Comme indiqué en préambule, selon l'analyse de CREA pour Carbon Brief, les technologies d'énergie propre ont contribué pour la première fois à plus de 10 % de la croissance économique chinoise en 2024. Les différents secteurs concernés ont généré un quart de la croissance du PIB national et ont même dépassé les ventes immobilières en valeur. L'année dernière, les investissements chinois dans les énergies propres étaient « proche du total des investissements mondiaux dans les énergies fossiles et d'une ampleur comparable à la taille globale de l'économie saoudienne ».

Certains observateurs soulignent toutefois des aspects qui ternissent l'image des stratégies chinoises. Selon le think tank économique indépendant Bruegel , entre 2020 et 2024, la Chine a installé une capacité de production d'énergie renouvelable sans précédent de 900 GW , sans pour autant parvenir à réduire son intensité énergétique et carbone de respectivement 13,5 % et 18 %, comme l'exigeait le 14e plan quinquennal du gouvernement. Cette situation s'explique principalement par la sous-utilisation généralisée des capacités de production d'énergie renouvelable installées et par la réduction croissante de ces capacités, conséquences du sous-investissement de la Chine dans son réseau électrique.
« Malgré la part croissante des énergies renouvelables dans la capacité installée, la part de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables reste faible, laissant la majeure partie de la consommation d’énergie aux combustibles fossiles », indique le centre de recherche.
La République populaire doit donc accroître ses investissements dans le réseau électrique national afin d'augmenter sa capacité de transport d'énergie. Ce processus est déjà enclenché, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires. Par ailleurs, elle doit se fixer des objectifs plus ambitieux en matière de capacité de stockage d'énergie pour soutenir le fonctionnement du réseau. « Grâce à des solutions de stockage intégrées ou autonomes, les projets d'énergies renouvelables peuvent mieux gérer la volatilité de la demande énergétique. »
Globalement, l'analyse de Bruegel conclut qu'en réorientant les investissements des capacités d'énergie renouvelable vers la modernisation du réseau électrique et des équipements, la Chine peut consolider une économie intérieure « autrement décevante », rester sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de zéro émission nette et atténuer les pressions géopolitiques.
elettricomagazine